Les
professionnels sociaux sont plus que jamais acteurs des politiques
migratoires. De lois en lois, ils se sont vu confier des compétences de
contrôle ou de sélection des migrants. Le tournant a été pris avec la
loi du 26 novembre 2003
qui confère aux centres communaux d’action sociale le soin de mener une
enquête auprès des familles qui feraient une demande d’attestation
d’accueil ou de regroupement familial. Citons également la
circulaire du 26 août 2012
« relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations
d’évacuation des campements illicites » qui prévoit un « diagnostic
social » avant toute expulsion. La prise en charge des mineurs isolés
constitue également une excellente illustration de ces nouvelles
missions. Les professionnels de l’action sociale interviennent à chaque
étape : de l’évaluation de la minorité et de l’isolement à
l’accompagnement. L’article L. 313.11 al. 2 bis du code de l’entrée et
du séjour et du droit d’asile les enjoint même de garantir l’absence de
lien entre le jeune et sa famille, son projet de formation ou son
insertion dans la société française. Plus récemment, que dire de la
levée du secret professionnel introduit par l’article 48 de la
loi du 7 mars 2016
pour permettre à la préfecture de vérifier l’exactitude des
déclarations des migrants qui sollicitent un titre de séjour Chacune de
ces réglementations a été imposée sans concertation préalable avec les
acteurs du secteur concerné. Caution ou garantie, les professionnels
sociaux sont en première ligne et souvent démunis face aux enjeux
politiques et éthiques que posent ces prérogatives nouvelles.
Leur
isolement est d’abord politique. Les corps intermédiaires et, en
particulier, les associations professionnelles sont particulièrement
fragiles et peu représentatifs. Il est d’ailleurs symptomatique que ni
l’Association nationale des assistants de service social (Anas) ni
l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (Ones) n’aient jugé
bon de soutenir Ibtissam Bouchaara, éducatrice spécialisée menacée de
licenciement pour avoir dénoncé les conditions d’accueil des mineurs
isolés (lire son témoignage dans
ce numéro).
Ce cas de figure sans précédent de sanction à l’encontre d’une
professionnelle sociale qui fait prévaloir éthique et déontologie de
l’action sociale aurait logiquement dû trouver écho auprès de ces
organisations. D’autant qu’elles participent à des instances nationales
comme le Haut Conseil du travail social ou le Conseil national de la
protection de l’enfance où leur point de vue peut trouver un large écho.
Un secteur peu structuré
La
faiblesse du corporatisme dans le champ du social est une conséquence
de son émiettement. Comment fédérer, mobiliser autour de combats communs
un professionnel d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) ou
chargé des mineurs isolés étrangers, d’un côté, avec des professionnels
du champ du handicap ou du vieillissement de l’autre On a pu constater
ce manque de cohésion par la faiblesse des mobilisations lorsque la loi
Sarkozy relative à la prévention de la délinquance de 2007 fut adoptée,
qui prévoyait le partage d’informations entre les professionnels sociaux
et les élus locaux. Plus récemment, cet émiettement corporatiste, et
donc cet isolement politique, a été manifeste lors de la suppression –
sans mobilisation commune – de la prévention spécialisée (éducateurs de
rue) dans une dizaine de départements. Les seules mobilisations
convergentes et récentes des acteurs se sont faites autour de la réforme
de la convention du 15 mars 1966 qui régit nombre d’établissements et
services médicosociaux (près de 250 000 professionnels). Autrement dit,
pour défendre le statut des professionnels plutôt que le public
accompagné.
Comment fédérer au demeurant des professionnels aux
convictions aussi différentes Le champ du social n’a pas échappé aux
poncifs actuels – parfois alimentés par les usagers eux-mêmes – sur les
étrangers, les fraudeurs, les délinquants, etc. Le racisme touche
désormais des secteurs professionnels qui en étaient jusqu’alors
préservés. Pendant longtemps, on a même pu penser qu’ils ne pouvaient
adhérer à ce discours et étaient, par définition, armés dans la lutte
contre la discrimination. Ce n’est que récemment que la question des
postures professionnelles face au racisme et de la formation spécifique à
ces enjeux a été posée
[1].
Les réductions budgétaires ont d’abord concerné les formations en
matière de droit des étrangers, mais surtout celles relatives à
l’ethnologie et à l’anthropologie, désormais considérées comme
accessoires. À l’inverse, des enveloppes budgétaires conséquentes se
sont récemment débloquées pour former, dans l’urgence et parfois la
contrainte, des milliers de travailleurs sociaux à la diversité
religieuse, à la laïcité mais surtout à la déradicalisation.
Le
profil des professionnels sociaux a par ailleurs considérablement
évolué. Le contexte économique a ici une double conséquence. D’abord, il
pousse certains à choisir les métiers sociaux par défaut, sans le
supplément d’âme qui animait leurs prédécesseurs – on parlait alors
d’engagement. Ils exercent ces métiers comme ils pourraient en exercer
d’autres, l’essentiel étant d’accéder à un emploi. Une analyse fine
montrerait à coup sûr un phénomène identique dans le recrutement des
enseignants.
Deuxième conséquence : il n’y a jamais eu autant de
proximité sociale et économique entre les aidants et les aidés. Faible
rémunération, contrats précaires, pointeuse et logique comptable sont
devenus le quotidien de l’action sociale. La durée des entretiens
sociaux est méthodiquement calculée – et tant pis si l’usager a besoin
de plus de temps du fait de son isolement, de son âge, de son handicap
ou de sa faible maîtrise de la langue. Quant à l’accompagnement... On
n’a jamais autant utilisé le terme d’accompagnement dans le champ de
l’action sociale depuis que les professionnels n’ont plus le temps, les
moyens ou l’envie de le faire.
Relisons le courrier, exemplaire à
ce titre, du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine à l’Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE,
novembre 2014). En réponse au collectif qui évoquait le difficile accès
des migrants à la CPAM du fait de la barrière linguistique, il
répondit : «
Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, la langue officielle en France est le français. » Et de renverser le schéma : «
Il
demeure indispensable que les personnes non francophones souhaitant
accéder à leurs droits soient en mesure de se faire (nous soulignons)
accompagner dans ces démarches. Cet accompagnement relève d’autres
acteurs, en particulier des associations. »
Les mêmes tensions
budgétaires ont conduit à des embauches au rabais de personnes faisant
fonction de travailleurs sociaux. Cette armée de réserve bon marché de
« médiateurs » sociaux, non diplômés, est particulièrement mobilisée
dans le champ du travail social auprès des migrants. L’absence de
formation, particulièrement sur les questions d’éthique, de distance,
d’empathie ou de responsabilité se fera inéluctablement sentir dans ses
positionnements quotidiens. Les identités professionnelles sont
méthodiquement écrasées, laissant supposer que tout le monde est un peu
éducateur ou assistant de service social. Dès lors, il ne faut pas
s’étonner que la réforme en cours des diplômes de travail social suscite
de vives inquiétudes. En regroupant les 14 diplômes en 4 grandes
filières sociales (éducative, sociale, familiale et managériale), il
s’agit officiellement d’avoir « un socle commun de compétences éthiques,
techniques et transversales permettant de renforcer la culture commune
des professionnels et de favoriser le travail en réseau, mais aussi les
mobilités professionnelles ». Ainsi, la création demain d’un métier
d’« intervenant social ou socio-éducatif » ne peut-elle qu’engendrer des
questionnements. Une fois de plus d’ailleurs, le champ de l’immigration
est un espace d’expérimentation préfigurant les pires évolutions. C’est
déjà le cas dans les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile
(Pada), les centres d’accueil et d’orientation des mineurs isolés
étrangers (CAOMI) ou les centres d’accueil et d’orientation (CAO)
[2]
où ont été recrutés des « intervenants sociaux » non formés à
l’intervention sociale : animateurs, juristes, éducateurs techniques
Pour les résultats que l’on connaît
[3].
Équilibre rompu
Ces
évolutions sont à replacer dans le contexte plus large du secteur
associatif social. Si dans certains champs d’intervention, le rapport
entre les pouvoirs publics et les associations est fait de
complémentarité et de respect du fait associatif – c’est
particulièrement le cas dans le champ du handicap –, cet équilibre est
rompu dans le champ de l’immigration. À l’échelle nationale, le tournant
a été pris sous la présidence de Nicolas Sarkozy avec la fusion au sein
d’un seul ministère, celui de l’intérieur, de l’ensemble des politiques
migratoires, y compris sociales et linguistiques qui relevaient
jusqu’alors du ministère des affaires sociales. Concrètement, cela
signifie, par exemple, que les centres sociaux et culturels qui assurent
les cours de français pour les migrants doivent vérifier que ces
derniers sont en situation régulière et ont bien signé le contrat
d’intégration républicaine (CIR), dont ils transmettent ensuite les
références à la préfecture. Dans le cas contraire, il en va de la
pérennité du financement de cette activité. La menace est identique pour
les professionnels des Cada, des travailleurs sociaux donc, qui
doivent, avec la plus grande célérité, « fluidifier » (euphémisme pour
dire expulser) le parcours en Cada une fois que la demande d’asile des
hébergés a été définitivement rejetée
[4], là aussi sous peine de sanctions financières.
Les
logiques d’appel d’offres et de mise en concurrence issues des traités
européens ont, tant au niveau national que local, brisé toute forme de
solidarité entre les acteurs associatifs. Dans le même temps, les
associations sont « invitées » à « mutualiser » ou à « fusionner » afin
de réduire les coûts d’exploitation sans aucune considération pour leurs
histoires, leurs valeurs, leurs projets associatifs et
leurs salariés. Récemment, au directeur d’un service intégré de
l’accueil et de l’orientation (SIAO)
[5]
qui rappelait à un préfet que l’accueil universel – avec ou sans
papiers – était inscrit dans les textes, il a été précisé que la
convention qui le liait avec les services de l’État prenait fin
prochainement et qu’une autre association était candidate avec
probablement moins d’états d’âme ! Pis, le secteur associatif est
instrumentalisé pour contourner et étouffer les réactions de
professionnels sociaux du secteur public. Dans le domaine du droit pénal
des mineurs, il en fut ainsi des centres éducatifs fermés, très
critiqués par les éducateurs du ministère de la justice (PJJ) qui
refusèrent d’y intervenir. Résultat : la grande majorité fut confiée au
secteur privé qui fit appel à des jeunes professionnels en contrats
précaires, peu ou pas formés, peu ou pas encadrés. Avec des dérives
pointées tant par le Défenseur des droits, le Contrôleur des lieux de
privation de liberté
[6] et le ministère lui-même
[7].
Ce
fut encore le cas, dans nombre de départements, lorsqu’il s’est agi de
faire le « tri » des mineurs isolés. Face aux résistances réelles ou
pressenties des professionnels du secteur public – ayant, eux, la
garantie de l’emploi et donc une plus grande liberté d’expression de
leur divergence –, le choix fut fait de confier cette mission à des
plateformes associatives liées par des conventions de partenariat de
courte durée et résiliables à merci, avec des prix de journée au rabais.
Comment s’étonner alors de l’absence de qualification et de formation
des professionnels positionnés sur ces missions
[8] ?
Au nom de la concurrence et de la prétendue qualité qu’elle engendrerait
[9],
les projets associatifs se réduisent aujourd’hui à attendre les
opportunités et les marchés. Les subventions de fonctionnement se font
de plus en plus rares ; seuls les commandes publiques et les appels à
projets permettent de boucler des budgets associatifs exsangues. De plus
en plus, les associations sont contraintes de lancer des actions sur
leurs fonds propres – quand elles en ont – avant de recevoir une réponse
à l’appel à projets auquel elles ont candidaté. Cette prise de risque
est particulièrement marquée pour les actions financées sur fonds
européens, le Fonds social notamment. Comment embaucher en CDI sans
avoir de garanties sur la pérennité de l’action entreprise ? En quelques
années, certaines associations sont devenues de grandes entreprises qui
ont recruté des spécialistes de la novlangue de l’appel à projets,
quand d’autres, plus chevillées à leurs valeurs, sont mortes. Sans
argent mais avec la gloire.
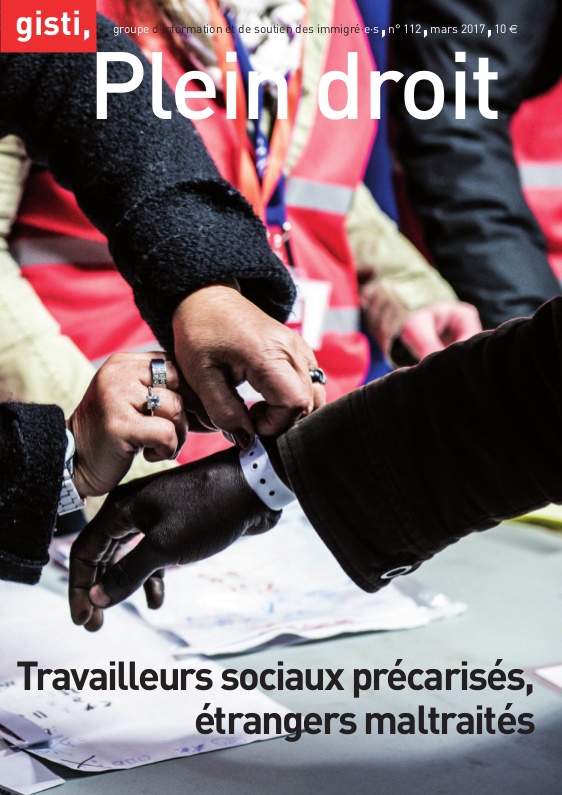

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire